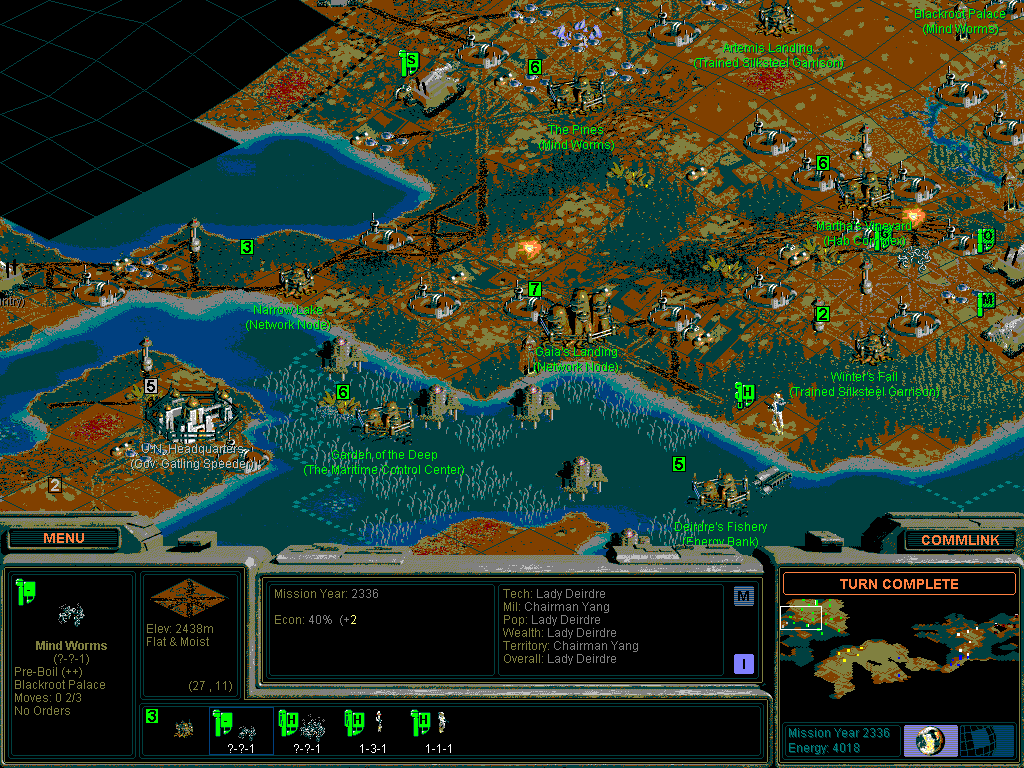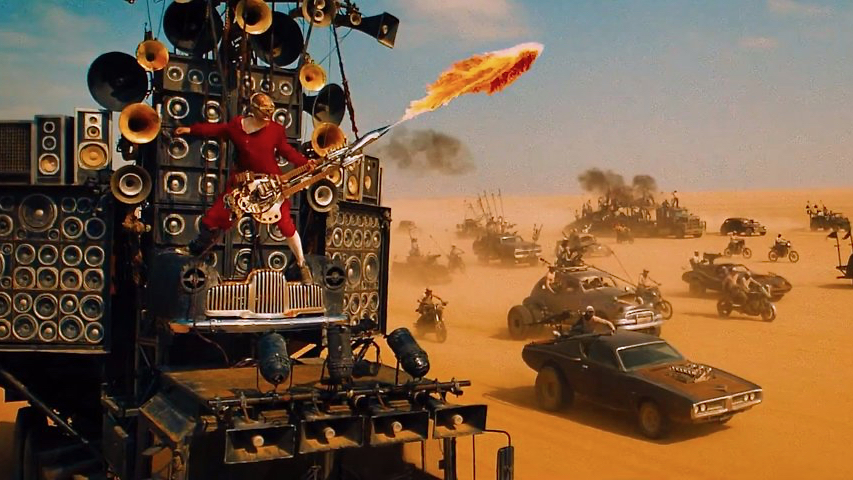En ces temps difficiles, je vous propose la lecture d’un texte mimétique, inspiré de Thucydide, par Procope, le plus célèbre historien du règne de Justinien Ier (527-565 ap. J.-C.). Il est difficile de déterminer dans quelle mesure cette description correspond à la réalité de l’épidémie tant le modèle de l’auteur l’a influencé. Néanmoins, un millénaire sépare les deux historiens et la dimension universelle de la maladie chez Procope révèle un cadre, celui de la romanité et du christianisme, qui est fort différent de celui de Thucydide. Ce dernier est caractéristique de l’émergence de la pensée classique fondée sur le logos. Dans l’oeuvre de Procope en revanche, il s’agit peut-être davantage d’un exercice de style codifié que d’une manière de décrire le phénomène. En parallèle à cette façon de concevoir l’histoire, par le prisme des auteurs classiques, une autre forme littéraire, la chronique universelle, émerge à cette époque. Son principal représentant est Jean Malalas.
Procope a également écrit une Histoire secrète.
Procope de Césarée, Guerre contre les Perses (Trad. Cousin), Paris, 1685, II, 22.
« 1. Il y eut en ces temps-là une maladie contagieuse, qui enleva une grande partie du genre humain. Elle fut attribuée au ciel et aux astres par certains esprits présomptueux, qui s’étaient accoutumés à inventer des opinions extravagantes et monstrueuses, et qui savaient bien eux-mêmes qu’ils ne disaient rien de solide, qu’ils ne cherchaient qu’à tromper les simples. Il est assurément difficile de se persuader, et encore plus de persuader les autres, qu’il y ait eu d’autre cause de ce mal que la volonté de Dieu. Il ne s’attacha pas à une partie de la terre, à un genre de personnes, à une saison de l’année ; si cela eut été, on aurait peut-être trouvé dans une de ces circonstances des raisons vraisemblables de son existence. Mais il embrasa tout le monde, il confondit toutes les conditions, et il n’épargna ni âge, ni sexe. Quelques différences qu’il y eût entre les hommes, soit par l’éloignement de leurs demeures, ou par la diversité de leurs coutumes, ou par l’antipathie de leurs inclinations, elles étaient inutiles pour les distinguer dans cette maladie, qui les égalait tous par le traitement qu’elle leur faisait Les uns en étaient attaqués en été, les autres en hiver, et les autres en une autre saison. Que les sophistes, et ceux qui font profession de connaître les météores, en discourent comme il leur plaira ; pour moi, je me contente de représenter fidèlement quel a été son commencement, son progrès et sa fin.
2. Elle commença par les Egyptiens de Péluse. De là elle se partagea, et alla, d’un côté vers Alexandrie, et de l’autre dans la Palestine. Ensuite avançant toujours, et avec une démarche réglée, elle courut toute la terre. Elle semblait garder une mesure égale, de s’arrêter un certain temps en chaque pays. Elle s’étendit jusqu’aux nations les plus éloignées, et il n’y eut point de coin, pour reculé qu’il pût être, où elle ne portât sa corruption. Elle n’en exempta ni île, ni montagne, ni caverne. S’il y avait quelque endroit ou elle n’avait point passé, ou bien qu’elle n’y eût passé que légèrement, elle y revint sans toucher aux lieux d’alentour, et elle s’y arrêta jusqu’à ce qu’elle y eut causé autant de morts et de funérailles, que dans les autres. Elle commençait toujours par les contrées maritimes, d’où elle se répandait sur celles qui étaient loin de la mer.
3. J’étais à Constantinople, lorsqu’elle y vint. C’était au milieu du printemps de la seconde année qu’elle y exerça et qu’elle y exerça sa fureur. Voici comment elle y arriva. Elle était précédée de fantômes revêtus de diverses formes. Ceux à qui ces fantômes apparaissaient, s’imaginaient en être frappés en quelque partie de leur corps, et en même temps ils étaient frappés de la maladie. Il y en avait qui tâchaient de s’en délivrer, en prononçant les plus saints noms qu’il y ait dans la religion, ou en faisant quelque cérémonie. Mais cela ne leur servait de rien, car ceux-même qui se refugiaient dans les églises, y trouvaient la mort. Il y en avait qui s’enfermaient dans leurs maisons, et qui ne répondaient point à la voix de leurs meilleurs amis, s’imaginant que c’étaient des diables qui les appelaient, et ils laissaient plutôt rompre leurs portes que de les ouvrir. Quelques-uns n’étaient pas attaqués de la peste de cette manière, mais cela leur arrivait en songe, et ils pensaient entendre une voix, qui les comptait au nombre des morts. D’autres sentaient le mal, sans en avoir eu de présage, ni dans le sommeil, ni hors du sommeil. C’était ou en s’éveillant, ou en se promenant, ou en quelque autre occupation, qu’ils s’apercevaient avoir la fièvre. Ils ne changeaient point de couleur. Ils ne sentaient point d’inflammation, et l’accès semblait si léger, que les médecins avaient peine à le reconnaître en tâtant le pouls, et qu’ils n’y voyaient aucune apparence de danger. Cependant sur le soir, ou le lendemain, il paraissait un charbon à la cuisse, ou à la hanche, et quelquefois sous l’aisselle, ou à l’oreille. Voilà ce qui arrivait presque à tous ceux qui étaient surpris de ce mal.
4. Je ne saurais dire si la diversité des symptômes procédait de celle des tempéraments, ou si elle n’avait point d’autre cause que la volonté de l’Auteur de la Nature. Les uns étaient accablés d’un assoupissement très profond, les autres étaient emportés d’une frénésie très-furieuse. Mais les uns et les autres souffraient extrêmement dans la différence de leur maladie. Ceux qui tombaient dans l’assoupissement oubliaient les fonctions les plus ordinaires de la vie, comme s’ils eussent été dans son sommeil éternel, tellement qu’ils mouraient de faim, si quelque personne charitable n’avait la bonté de leur mettre les aliments dans la bouche. Les frénétiques n’avaient jamais de regrets. Ils étaient toujours troublés par l’image de la mort, et s’imaginaient être poursuivis. Ils s’enfuyaient, en jetant des cris épouvantables. Ceux qui les gardaient avaient une fatigue insupportable, et n’étaient guère moins à plaindre que leurs malades. Ce n’est pas qu’ils fussent en danger de gagner le mal, car personne ne le gagna par la fréquentation des malades, et plusieurs l’eurent sans les fréquenter. Mais c’est qu’ils souffraient beaucoup de peine, lorsque les malades se roulaient par terre, et qu’ils étaient obligés de les relever, ou qu’il fallait les empêcher de se jeter du haut des maisons, et de se précipiter dans l’eau. Ce n’était pas aussi un petit travail, que de leur faire prendre de la nourriture. Car il y en eut qui périrent faute de manger, comme d’autres périrent par leurs chutes. Ceux qui n’eurent ni assoupissement, ni frénésie, moururent d’une autre manière. Leur charbon s’éteignait et ils étaient enlevés par la violence de la douleur. On peut juger par conjecture que les autres, dont je viens de parler, enduraient le même mal. Mais peut-être qu’ils en avaient perdu le sentiment, en perdant l’usage de la raison. Les Médecins étonnés de la nouveauté de ces accidents, et se doutant que la cause principale du mal résidait dans les charbons, se résolurent de la découvrir, et en ayant fait l’anatomie sur des corps morts, ils y trouvèrent en effet une grande source de corruption. Quelques-uns mouraient le jour-même qu’ils étaient frappés, et les autres les jours suivants. Il y en avait à qui il s’élevait par tout le corps des pustules noires, de la grosseur d’un pois ; et ceux-là ne passaient jamais le jour, et quelquefois ils expiraient à l’heure-même. Il y en eut qui furent étouffés par une grande abondance de sang, qui leur sortit de la bouche.
5. Je puis assurer que les plus fameux médecins prédirent la mort à des personnes qui échappèrent à toute sorte d’espérance, et qu’ils prédirent la guérison à d’autres qui mouraient bientôt après, tant ce mal était impénétrable à la science des hommes, et tant il était accompagné de circonstances contraires à la raison et à l’apparence. Le bain servait aux uns et nuisait aux autres. Quelques-uns mouraient faute de remèdes, et d’autres se sauvaient sans ce secours. Les remèdes produisaient des effets tout contraires à leur nature, tellement qu’il n’était pas moins impossible de chasser la maladie, lorsqu’elle était venue, que de l’empêcher de venir. On y tombait sans sujet et on s’en relevait sans assistance. Les femmes grosses, qui étaient atteintes de cette contagion, n’évitaient point la mort, et quoiqu’elles portassent leurs enfants jusqu’au terme ordinaire, ou qu’elles accouchassent devant, elles étaient enlevées hors du monde, avec les enfants qu’elles venaient d’y mettre. On dit néanmoins qu’il y eut trois mères qui survécurent à leurs enfants, et un enfant qui survécut à sa mère. Ceux à qui le charbon croissait, et aboutissait en pus, recouvraient la santé, l’expérience ayant fait voir que c’était un signe que la plus grande ardeur du mal était éteinte. Ceux au contraire, dont le charbon demeurait toujours au même état, souffraient tous les accidents dont nous venons de parler. Il y en avait à qui la cuisse se desséchait ; ce qui était cause qu’il ne sortait plus d’humeur du charbon. D’autres en échappèrent, à qui il demeura un défaut à la langue, qui les rendit bègues pour toute leur vie. »