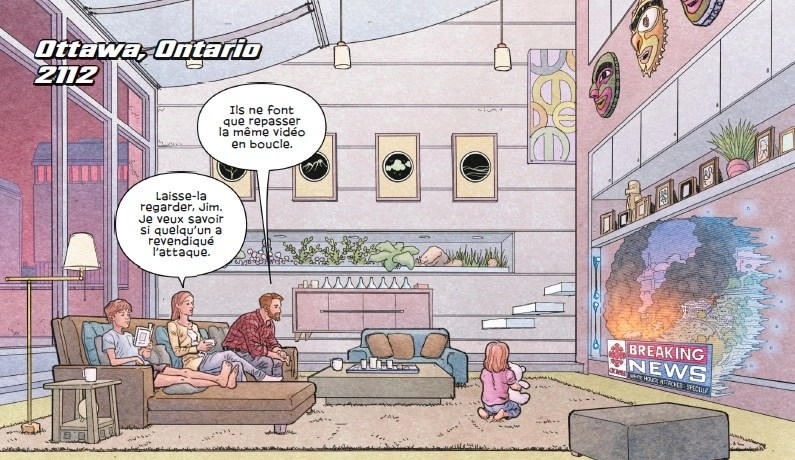La série vidéoludique Civilization, de Sid Meier, est sans aucun doute le plus emblématique des 4X, ces jeux de stratégie appelés ainsi à cause de ce qu’ils proposent aux joueurs : eXplore, eXpand, eXterminate, eXploit (explorer, s’étendre, exterminer et exploiter). Cette terminologie, qui fait quasiment office de définition, place immédiatement au centre du sujet. Il s’agit de croître en faisant plus qu’aménager. Il faut aussi détruire et combattre, une logique qui a déjà été en partie étudiée sur ce site avec l’article sur la “suite” de Civilization, Alpha Centaury. Dès la première version, en 1991, le jeu propose de créer une civilisation et de la faire vivre sur plusieurs milliers d’années depuis les temps protohistoriques jusqu’aux temps futurs. On peut gagner une partie en conquérant les autres civilisations, en l’emportant aux points après un certain nombre de tours ou en étant le premier à envoyer un vaisseau en orbite autour d’Alpha du Centaure. Les civilisations sont structurées autour de leurs villes, où l’on peut construire des bâtiments, et elles exploitent un arrière-pays plus ou moins intéressant selon l’emplacement choisi. Le jeu s’effectue en tour par tour avec une arborescence scientifique qui permet la progression à travers les grandes périodes comme l’Antiquité ou le Moyen-Age. Les versions suivantes ont ajouté les éléments qui augmentent la complexité du jeu sans en modifier le principe, comme la culture, la religion ou le commerce.
Si l’on considère les ressources, il faut noter que celles-ci ne sont pas épuisables. Il y a une bonne et une mauvaise manière de les utiliser (y compris pour l’environnement) mais la déplétion n’existe pas. La pollution existe depuis le premier Civilization, elle apparait à l’ère industrielle comme une sorte de “crasse” qui rend l’exploitation des cases impossible. Des ouvriers peuvent néanmoins la nettoyer sans restriction. Cela demande juste de la formation et du temps. La pollution constitue donc une simple entrave qui n’est jamais irréversible. Mais cela devient encore plus significatif lorsqu’on parle de réchauffement climatique d’origine humaine. Il faut souligner que, dès le premier titre, le problème peut survenir dans le jeu. Alors que des polémiques surviennent de nos jours régulièrement pour déterminer qui savait quoi et à quel moment, Sid Meier incorpore le réchauffement climatique à son jeu de stratégie en 1991. Une telle lucidité mérite d’être saluée. Cependant, dans les quatre premiers Civilization, le réchauffement climatique est mécaniquement lié à la pollution. Plus il y a de cases “encrassées” plus le réchauffement peut, partout dans le monde, transformer une case de plaine en case de prairie ou une case de prairie en case de désert. Il modifie donc les caractéristiques du terrain.

Ce lien univoque entre pollution et réchauffement implique de se représenter ce dernier comme la conséquence de mauvaises habitudes qu’il faudrait “nettoyer” pour ne pas avoir à subir le problème. Cela n’empêche pas de continuer à se développer par ailleurs, puisque la production augmente même (surtout) si la question du réchauffement est bien gérée. Dans Civilization V (2010), le réchauffement climatique a tout simplement disparu. On peut se demander s’il s’agit d’un simple oubli, d’une facilité ou si les polémiques médiatiques, très vives à ce moment-là sur le sujet, ont conduit les concepteurs à éliminer cette caractéristique du jeu. En revanche, elle fait un retour fracassant avec l’extension de Civilization VI : Gathering Storm (2019). On y voit le réchauffement apparaître en fin de partie, avec l’ère industrielle, et être l’objet d’un écran complet avec de nombreuses statistiques. Si les problèmes climatiques sont fréquents dans le jeu (sécheresses, tornades, etc.), le réchauffement est le seul qui peut tous les impliquer et davantage encore. Il cause la fonte des glaces, ce qui permet plus facilement la circumnavigation, et provoque la submersion d’une partie des côtes. Il se compose aussi de plusieurs stades, croissants en termes de catastrophes, ainsi que par l’impossibilité de revenir au stade précédent. Le réchauffement peut être freiné ou stoppé mais il ne reflue pas. Néanmoins, on freine toujours le problème par un effort d’activité, pas par de la sobriété. On achète ou on produit de la dépollution, cela permet de continuer à croitre (par exemple pour aller sur Mars).
Au total, il est possible de constater trois conceptions du réchauffement climatique d’origine humaine et industrielle dans la série Civilization. La première, avant-gardiste, écologiste et productiviste, concerne les épisodes 1 à 4. Elle a le mérite de mettre en avant un problème qui, à l’époque, passait au mieux pour une curiosité, mais avec des bases dont nous voyons aujourd’hui qu’elles ont leurs limites. La deuxième, dans Civilization V, que l’on pourrait qualifier de climato-amnésique, gomme le problème au moment où celui-ci monte en puissance dans les médias. Enfin, la troisième, dans Civilization VI : Gathering Storm, reprend la première, la perfectionne fortement et ajoute quand même une irréversibilité qui n’existait pas. Le phénomène marque maintenant la fin d’une partie alors qu’il était, dans les versions précédentes, un désagrément marginal. Son traitement dans l’ensemble de la série révèle surtout la difficulté qu’a l’industrie vidéoludique à intégrer les problèmes écologiques sans changer radicalement son paradigme, celui d’une sorte de front pionnier scientifique et industriel dont le défrichement symbolique est peu compatible avec une lutte sobre contre le réchauffement. Reste à savoir comment le thème va évoluer dans son traitement dans les prochains titres et si le modèle qu’est Civilization peut physiologiquement se réinventer sur ce point.